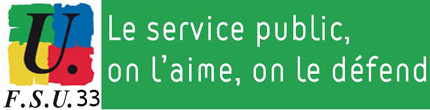13 mai 1968–13 mai 2003. « Sous les pavés, la plage », disait-on il y a juste 35 ans.
Et sous les retraites, qu’y a-t-il ? On reste un peu abasourdi devant l’indigence des arguments ressassés par la propagande libérale.
Les augures du vieillissement démographique ignorent-ils que les gains de productivité compenseront la diminution de la proportion d’actifs par rapport aux retraités ? Oublient-ils que depuis 20 ans la part de la masse salariale dans le PIB français a perdu 10 points et qu’on pourrait envisager d’inverser la tendance pour prendre en charge des retraités plus nombreux et leur assurer une progression du niveau de vie identique à celle des salariés ? Les adeptes de l’allongement de la durée de cotisations n’ont-ils pas compris que celui-ci n’augmentera pas le taux d’activité tant que l’emploi ne progressera pas ? Les thuriféraires des fonds de pension ne savent-ils pas que ceux-ci ne produisent rien ?
N’en doutons pas : aucune de ces réalités n’échappe à la sagacité de nos dirigeants et de leurs experts ès démolition sociale. Il doit donc exister des raisons plus profondes qui expliquent l’acharnement à remettre en cause le système de retraites par répartition, à organiser une baisse considérable du niveau des pensions collectives de façon à inciter les salariés les mieux rémunérés à effectuer des placements financiers individuels. La protection sociale assurée par la collectivité à l’ensemble de la population est impensable pour les gourous de la « mondialisation heureuse ». On pourrait y voir la main des assureurs pour qui le risque est la matière première source de profits et qui piaffent en faisant le siège de la Sécurité sociale. C’est certain et le FMI en a fait le cynique aveu : « Un système de retraites par répartition peut déprimer l’épargne nationale parce qu’il crée de la sécurité dans le corps social. » Mais cela ne suffit pas pour comprendre la violence du patronat et du gouvernement contre les retraites.
Il y a plus grave qui leur rend la chose insupportable. Le système de retraites par répartition instaure une dette sociale et pérennise sa transmission intergénérationnelle. Une dette qui s’éteint et renaît à chaque instant. La génération qui travaille éteint sa dette vis-à-vis de la génération précédente qui lui a donné la vie et l’a élevée et elle enclenche une dette que contracte à son tour la génération suivante à son égard.
Quelle abomination ! Une dette collective sans fin au royaume des rapports marchands individuels ! Le capitalisme ne (re)connaît que des dettes privées et des échanges commensurables qui, une fois conclus, laissent les partenaires quittes les uns envers les autres. J’ai acheté une marchandise, j’ai payé le vendeur et jamais plus nous n’aurons à faire ensemble car la dette s’est éteinte définitivement. L’exact opposé de la dette sociale qui se transmet indéfiniment.
Peut-on imaginer pire pour ceux qui souffrent de névrose obsessionnelle de la rentabilité ? Oui, il y a pire encore. Les retraites par répartition présentent une grande similitude avec le principe du don : « donner, recevoir, rendre ». Celui qui donne n’attend pas de retour équivalent. Ainsi, les cotisations sociales servent à payer les retraites dans l’instant et ne sont pas égales à ce que percevront plus tard les cotisants actuels qui dépendront de la production future. Celui qui reçoit accepte le bienfait sans comparer avec ce qu’il a donné ou bien il rendra sans compter, c’est-à-dire sans comparer avec ce qu’il a reçu. En inventant la Sécurité sociale et les retraites par répartition, on a donné une place à une sphère non marchande assumée collectivement et on a réintroduit le paradigme du don exclu par le capitalisme tout en se démarquant radicalement d’une conception charitable de l’aumône faite entre des individus.
Pourquoi les retraites ne se laissent-elles pas voir ainsi ? Parce qu’elles sont victimes d’un paradoxe. La dette transmise de génération en génération par une chaîne ininterrompue de dons prend la forme monétaire puisque les cotisations sociales sont prélevées sur la valeur monétaire ajoutée par le travail et que les pensions sont ensuite, très logiquement, des revenus monétaires. L’outil privilégié de la relation marchande, la monnaie, sert aussi à assurer des rapports non marchands. Il y a de quoi s’y perdre et sans doute faudrait-il réviser les conceptions habituelles de la monnaie en même temps que l’on transformerait les rapports sociaux. Le don – inadmissible au sein du capitalisme – qui transparaît dans les retraites doit être considéré comme essentiel à la vie. Il n’est pas sûr en revanche que le capitalisme soit aussi vital.
Economiste, Université Bordeaux IV, ATTAC, Fondation Copernic,
http://harribey.montesquieu.u-borde….
 GIRONDE
GIRONDE